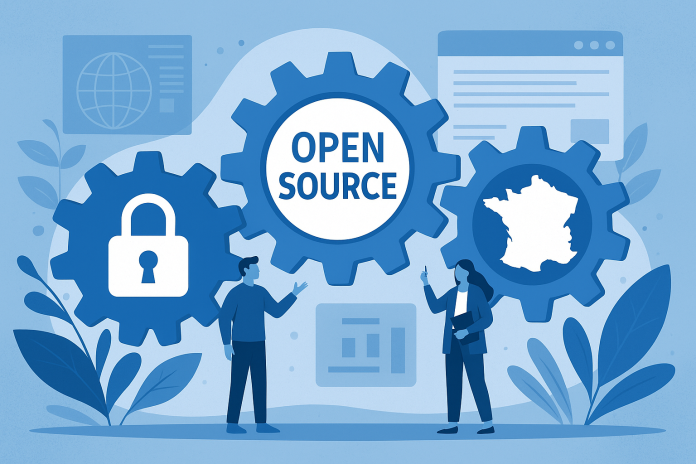Le CNLL alerte sur l’usage flou du terme « communs numériques » dans les politiques publiques. Ce qui est mis en cause notamment c’est une stratégie de vocabulaire qui favoriserait certains projets open source au détriment des éditeurs français de logiciels libres, en contradiction avec la loi pour une République numérique.
Le Conseil national du logiciel libre (CNLL), qui fédère plus de 300 entreprises du secteur en France, tire la sonnette d’alarme. Dans un communiqué publié en juillet 2025, l’organisation dénonce les effets pervers de la terminologie utilisée par l’État dans les politiques numériques. En particulier, elle pointe l’usage du terme « communs numériques », qui masquerait selon elle une mise à l’écart des éditeurs de logiciels libres français au profit de projets communautaires flous, souvent dominés par de grandes fondations internationales.
Un « vocabulaire stratégique » lourd de conséquences
Pour le CNLL, le choix entre les notions de « communs numériques » et de « biens publics numériques » n’est pas anodin. Il reflète une orientation stratégique qui « conditionne la capacité de la France à bâtir une souveraineté numérique réelle, fondée sur un écosystème industriel fort, des emplois qualifiés et une innovation durable ». L’organisation alerte : en exigeant des critères de « gouvernance communautaire », l’État exclurait de fait de nombreux logiciels libres portés par des éditeurs français.
Ce glissement sémantique irait à l’encontre de l’article 16 de la loi pour une République numérique de 2016, qui promeut explicitement l’utilisation de logiciels libres dans les administrations, sans imposer ce type de conditions.
Un rappel à la définition inclusive de l’ONU
Le CNLL appelle à s’aligner sur la définition des biens publics numériques proposée par les Nations unies dans son plan d’action pour la coopération numérique (2020). Y sont inclus : logiciels libres, données ouvertes, modèles d’IA open source, standards ouverts et contenus libres, dès lors qu’ils respectent la vie privée et ne causent pas de préjudice. Surtout, cette définition est inclusive et reconnaît le rôle de tous les acteurs (États, secteur privé, société civile) dans la construction de solutions numériques ouvertes et durables.
Un écosystème menacé
Selon le CNLL, en finançant des projets sous gouvernance communautaire peu structurée, l’État contribue à diluer les responsabilités et à créer des alternatives parcellaires. Ces projets, souvent des dérivés (forks) de solutions existantes, manquent de vision stratégique, de support professionnel et de garanties de sécurité, autant d’éléments que les éditeurs français apportent, notamment via des modèles économiques variés (support, SaaS, open core…).
« Le métier d’éditeur de logiciel libre consiste à développer un projet open source en tant que produit industrialisé, fiable et pérenne », rappelle l’organisation. L’approche actuelle, selon elle, ne crée pas de véritables alternatives souveraines, mais marginalise des acteurs structurants de l’innovation française.
Une demande claire aux pouvoirs publics
Le CNLL demande :
- L’application stricte de la loi République numérique, notamment son article 16.
- La reconnaissance officielle de la terminologie “biens publics numériques”, telle que définie par l’ONU.
- L’arrêt du financement de logiciels concurrents aux offres déjà existantes sur le marché français.
- L’ouverture d’un dialogue régulier entre l’État et les représentants de la filière open source industrielle.
Un nouveau signal fort à l’heure où la commande publique et les politiques numériques sont de plus en plus scrutées sur leur cohérence avec les ambitions affichées en matière de souveraineté et de transition numérique.