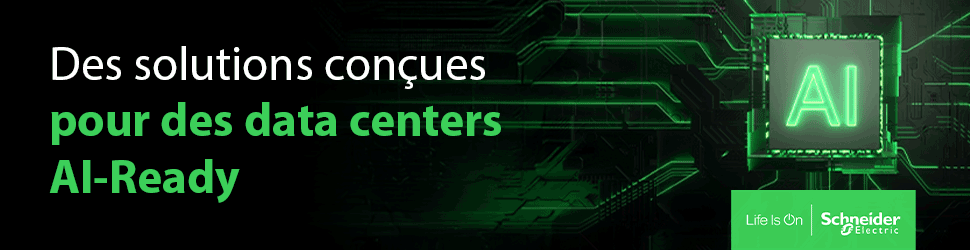La Commission européenne lance le Digital Commons European Digital Infrastructure Consortium (DC-EDIC), un instrument de gouvernance commun dédié au développement d’infrastructures et de technologies numériques européennes. Ce consortium marque une nouvelle étape vers une souveraineté numérique européenne plus concrète : bâtir des “communs numériques” au service des États, des entreprises et des citoyens.
Un cadre commun pour la souveraineté numérique
Depuis plusieurs années, la Commission européenne multiplie les initiatives pour réduire la dépendance du continent à l’égard des technologies et infrastructures importées. Cette dépendance, longtemps considérée comme un risque économique, est désormais perçue comme une vulnérabilité démocratique. Le DC-EDIC s’inscrit dans cette logique de reconquête : il doit fournir à l’Union un cadre opérationnel et juridique pour développer, exploiter et maintenir des infrastructures numériques partagées.
En choisissant d’installer le siège du DC-EDIC à Paris, la Commission envoie un signal politique fort : celui d’une Europe qui veut affirmer sa capacité à concevoir ses propres briques technologiques. Les quatre États fondateurs (France, Allemagne, Italie, Pays-Bas) forment le noyau initial, mais le consortium est conçu pour rester ouvert à d’autres pays qui souhaiteraient s’y joindre « à des conditions équitables et raisonnables ».
Cette ouverture traduit l’esprit du projet : favoriser la coopération plutôt que la compétition entre États membres, autour d’une vision partagée des infrastructures numériques comme biens communs, c’est-à-dire des ressources ouvertes, réutilisables et gouvernées collectivement.
Un instrument tourné vers l’action et la mutualisation
La mission du DC-EDIC est d’accélérer la mise en œuvre d’un projet multinational sur les biens communs numériques, en concentrant les efforts sur deux axes prioritaires : les infrastructures et services de données communs européens, et l’administration publique connectée.
Concrètement, le consortium servira à coordonner les ressources publiques, privées et civiques déjà mobilisées dans ces domaines, tout en simplifiant l’accès aux financements européens. Un guichet unique, à la fois physique et en ligne, doit être créé d’ici 2027 pour orienter les acteurs vers les fonds disponibles et les accompagner dans leurs projets.
Le DC-EDIC n’a pas vocation à devenir une structure centralisée, mais à agir comme un réseau fédérateur. Il s’appuiera sur une communauté européenne d’acteurs publics, privés et civiques, encourageant la collaboration sur des projets concrets : développement de logiciels open source, interconnexion des systèmes publics, partage sécurisé de données, ou encore mutualisation d’outils d’analyse.
Dans la pratique, sa gouvernance s’articulera autour d’une assemblée des membres, chargée d’adopter la stratégie de mise en œuvre, d’un directeur responsable de la gestion quotidienne et d’un conseil consultatif pouvant formuler des orientations stratégiques.
Transparence et open source : les piliers du modèle
L’une des particularités du DC-EDIC est donc de placer la transparence au cœur de sa philosophie. Tous les logiciels développés conjointement seront, par défaut, publiés sous licence libre et open source. Ce choix, stratégique, vise à maximiser la réutilisation des solutions et à garantir la confiance dans les outils produits.
La feuille de route prévoit plusieurs étapes clés. D’ici la fin de 2025, le consortium doit être officiellement lancé, après le recrutement de son directeur et de l’équipe fondatrice. Puis, d’ici 2027, un guichet unique et un pôle d’expertise opérationnels devraient voir le jour. La Commission prévoit également la création d’un forum européen sur les communs numériques, d’un prix annuel pour valoriser les initiatives locales, et d’un rapport annuel sur l’état des communs numériques. Ces éléments visent à inscrire le projet dans la durée et à le relier aux grands programmes européens existants, notamment Digital Europe, Gaia-X ou l’European Open Science Cloud (EOSC).
En lançant le DC-EDIC, l’Europe ne cherche plus seulement à combler ses retards technologiques : elle veut structurer un cadre commun pour produire, partager et sécuriser ses propres outils numériques. En misant sur l’open source et la coopération transfrontalière, l’Union trace les bases d’un marché européen des communs numériques. Une manière de rappeler que la souveraineté numérique se construit d’abord dans la capacité à créer ensemble.